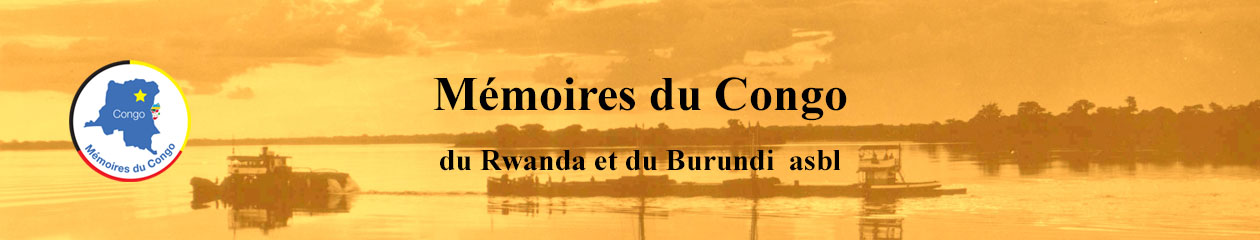Traduction de l’article paru dans la revue
S’il y a jamais eu un colonial hors du commun, c’est bien la figure de notre regretté ami Cyriel Van Meel qui doit nous venir à l’esprit. On serait tenté de croire qu’il était prédestiné à vivre en Afrique. Même bien plus qu’en Afrique car après ses années au Congo il a su se créer une existence d’explorateur qui allait le conduire jusqu’aux extrémités du globe.
Cyriel était un homme aux talents multiples : clairvoyant et énergique, il avait tout autant des dons d’artiste et d’organisateur, en même temps que sur le plan intellectuel rien ne le laissait indifférent, même pas le cosmos. Pour autant, loin de s’adonner à un vain dilettantisme, il avait une vive notion des grandes valeurs qui marquent notre existence, où la nature jouait pour lui un rôle primordial.
Dès son jeune âge, son indomptable vitalité devait l’inciter à s’orienter vers des horizons lointains : il ne fallait donc pas s’étonner, au milieu du siècle dernier, que le Congo Belge ait suscité en lui un vif intérêt. Sa confrontation avec l’immensité de la nature congolaise et le mystère de l’homme africain allaient avoir sur lui un impact décisif pour le reste de son existence. Fin esprit comme il était, il réussit à se familiariser intelligemment avec l’âme bantoue et à nouer avec ce monde de réelles relations de confiance.
Suscitant l’étonnement général, il renonça très vite à sa première affectation, à savoir le service d’Hygiène de l’OTRACO (l’Office des Transports publics au Congo) à Léopoldville, car il n’y avait pas découvert toute l’authenticité africaine à laquelle il aspirait. Non, il préférait de loin s’immerger dans l’immensité des forêts vierges du Kasaï où, notamment, il eut aussitôt l’occasion de se familiariser avec la vie des Pygmées et des Pygmoïdes.
Quelque temps après, il est appelé à assurer le service médical au sein d’une expédition chargée d’engager une lutte désespérée contre la plaie des jacinthes d’eau qui menaçait d’entraver sérieusement la navigation sur le fleuve Congo : voilà le départ d’une nouvelle vie, âpre et pleine d’aventures, sur une flottille de vieux bateaux de rivière. Et cependant : « nonobstant la chaleur torride, la transpiration, les moisissures, la puanteur, les moustiques, la malaria, les dépressions, les morsures de serpents et même les noyades, je considère cette période de ma vie comme une expérience extrême de liberté et de communion avec la nature », écrira-t-il plus tard dans le livre qu’il a consacré à cette aventure. Sous le titre « Congo ya sika », cet ouvrage a été publié en version néerlandaise et française.
Lors de son deuxième terme, Cyriel se voit désigné pour une mission chez les fameux Bayaka du Kwango, cette fois dans le cadre du FOREAMI (le Fonds Reine Elisabeth pour l’Assistance médicale au Congo). Dans le cadre de la lutte contre les maladies endémiques, il a la charge des recensements médicaux et obtient en peu de temps la confiance des chefs indigènes et des féticheurs, qui n’hésitent pas à l’initier à leurs secrets et leurs histoires. Il vit intensément et intimement ce nouvel environnement auquel il va bientôt consacrer un deuxième livre.
Hélas, la fièvre indépendantiste viendra malencontreusement brouiller les cartes. Peu de jours après le 30 juin 1960, Cyriel est confronté à de gros problèmes à la suite d’une mutinerie du détachement local de la Force publique, ce qui va l’obliger à prendre le chemin vers l’Angola. Après un épouvantable voyage de plusieurs jours par des routes à peine carrossables, il finit par atteindre Luanda. Une traversée maritime, dans un état d’esprit qui se devine, consacre la fin de ce beau rêve africain.
Mais pas de courage perdu pour autant ! Sans défaillir et plein d’énergie, Cyriel réussira à se bâtir bien vite une nouvelle existence. Inventif, entreprenant et même intrépide comme il est, il s’ingénie à organiser des voyages au long cours qui vont le conduire aux quatre coins du globe : le Kenya, le Canada, les Pôles Nord et Sud, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, la Laponie, le Kilimandjaro, etc. etc. mais il y avait aussi et surtout Hawaï (Molokaï) car pour un digne citoyen de Tremelo comme Cyriel Van Meel, il n’aurait pas été imaginable d’oublier le Père Damien.
Mais nonobstant toutes ces activités, le Congo ne s’efface pas de son esprit : il y retournera à deux reprises, la dernière fois même en atteignant son dernier poste : Popokabaka, où il a la chance de retrouver plusieurs anciens fidèles parmi son personnel de jadis. L’étonnement, l’émotion et les embrassades se devinent et les souvenirs du « bon vieux temps » foisonnent. Mais il n’y aura plus de troisième voyage car trop d’ombres sont venues assombrir l’image qu’il avait gardée du ‘temps des Belges’. Il doit constater que la faune aussi a fort souffert du cours des événements. Le symbole qu’il choisit comme interprète de cette hécatombe est le bolikoko, cet oiseau mythique à ses yeux, dont il ne percevra plus le cri si caractéristique. Il trouvera à exprimer parfaitement les sentiments qui l’animent à ce propos dans son deuxième livre qui est présenté en version française sous le titre : « Depuis, le bolikoko s’est tu ».
Entretemps, il est entré en contact avec l’association « Mémoires du Congo » qui venait d’être créée. Il y prend en charge l’enregistrement d’une longue série de témoignages d’anciens d’Afrique néerlandophones. Mais dès lors qu’il s’avère préférable de mettre en place – de commun accord – une structure distincte pour ce qui concerne sa propre communauté linguistique, il joue un rôle moteur comme cofondateur du mouvement « Afrikagetuigenissen », le spin-off de l’association-mère.
Contribuer à la défense de l’honneur et des intérêts de ceux qui se sont engagés pour le bien-être des populations congolaises et pour le progrès, demeure tout sauf un vain mot pour lui. Jusqu’à la fin de sa vie, il restera plein d’ardeur pour sauvegarder les souvenirs de ce qui est si généralement considéré comme « les plus belles années de ma vie ». Et même dans ses derniers jours, alors qu’il sentait ses forces décliner, il avait encore la tête pleine de plusieurs projets qui lui tenaient à cœur.
Son exemple rayonnant n’est pas près de s’effacer de nos mémoires.
Guido Bosteels